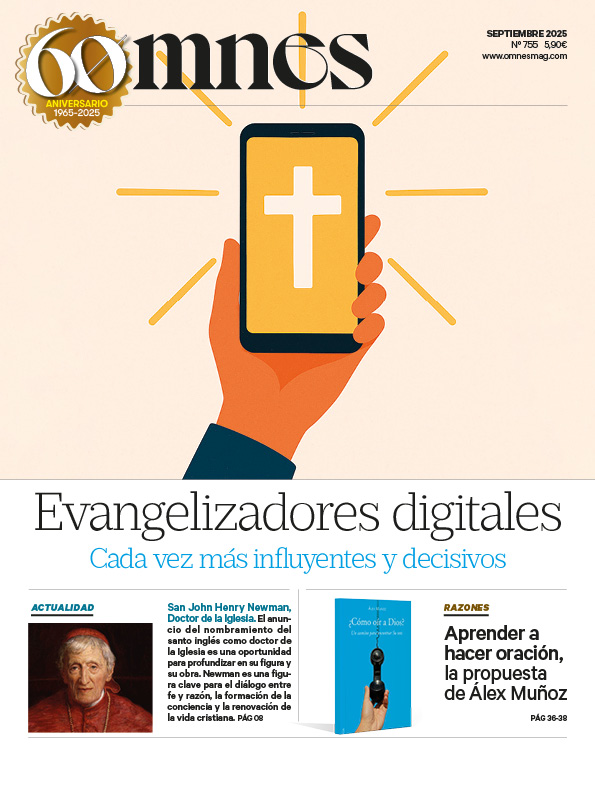Mónica Santamarina est la présidente générale de la Union mondiale des organisations féminines catholiques et son Observatoire mondial des femmes. Son expérience professionnelle lui permet de voir de très près la réalité de nombreuses femmes dans le monde, y compris au sein de l'Église. C'est pourquoi, dans cet entretien, elle analyse les progrès réalisés au cours du pontificat de François en faveur d'une plus grande inclusion des femmes. En même temps, elle propose des mesures qui aideront à continuer à s'améliorer dans ce domaine.
Selon vous, comment le pape François a-t-il abordé le rôle des femmes dans l'Église par rapport à ses prédécesseurs ? Quelles ont été les avancées les plus significatives au cours de son pontificat ?
– Tanto Saint Jean Paul IIcomme Benoît XVILe Pape, surtout le premier, a parlé et promu à travers son magistère le rôle pertinent des femmes dans l'Église et l'importance de l'assumer pleinement. Mais c'est sans conteste le pape François qui a abordé la question avec beaucoup plus de force, de clarté et d'ouverture, lui conférant ainsi une plus grande pertinence.
Il convient tout d'abord de souligner l'importance de la constitution apostolique ".Praedicate Evangelium"(2022), où il est précisé que chacun peut diriger un dicastère, ce qui inclut les laïcs, hommes et femmes, qui peuvent être nommés pour exercer des fonctions de gouvernance et de responsabilité au sein de la Curie romaine. C'est à partir de là que l'on commence vraiment à voir une plus grande présence de laïcs et de femmes à des postes de responsabilité dans l'Église.
En outre, le discours du Saint-Père a été encore plus percutant :
- Sa conviction pleine et évidente de tout ce que les femmes peuvent et doivent apporter à l'Église, y compris leur leadership et leur participation à la prise de décision, selon leur vocation, leurs charismes et leurs ministères propres et dans les limites claires de ce qui correspond exclusivement au sacerdoce.
- Le témoignage qu'il a donné en plaçant des femmes à des postes clés dans les dicastères et autres organes de la Curie romaine.
- L'inclusion de femmes dans la dernière Assemblée synodale, dont beaucoup ont pu s'exprimer et voter.
Le pape François a parlé de l'importance d'une plus grande participation des femmes à la prise de décision au sein de l'Église. Comment évaluez-vous les progrès concrets à cet égard, en particulier en ce qui concerne les postes de direction et de responsabilité ?
- Fidèle à son discours et à sa conviction de la capacité et de la coresponsabilité des femmes dans une Église synodale missionnaire, le pape François a commencé par placer des femmes à certains des postes les plus importants dans divers dicastères et autres organes ecclésiastiques historiquement confiés à des hommes.
Nous avons donc aujourd'hui trois femmes membres du Dicastère des évêques, dont l'ancienne présidente générale de notre organisation, Mme Maria Lia Zervino. Nous avons Nathalie Becquart, sous-secrétaire du Secrétariat général du Synode des évêques, dont le travail a été et est indispensable à la réforme synodale de l'Église.
Alessandra Smerilli, Secrétaire du Dicastère pour le service du développement humain intégral et Dr. Linda Ghisoni et Prof. Gabriella Gambino, Sous-Secrétaires du Dicastère pour les laïcs, la famille et la vie. Toutes ces personnes, et bien d'autres encore, ont sans aucun doute accompli un travail remarquable et démontré la grande capacité des femmes.
Enfin, après un long parcours, le pape a annoncé, en janvier, la nomination de la première femme au poste de préfet du dicastère pour les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique : Sœur Simona Brambilla. Tout cela était impensable il y a peu.
Selon vous, quelles sont les mesures qui doivent encore être prises pour garantir une plus grande inclusion des femmes dans ces espaces ?
- Le problème est que cette conviction du pape François, déjà élevée au rang de magistère de l'Église après l'Assemblée synodale, n'est pas partagée par tous les évêques, prêtres, religieux et religieuses, ni par les laïcs eux-mêmes, hommes et femmes.
Nous devons surmonter le cléricalisme encore présent dans le monde et le remplacer par une culture du dialogue et de la confiance dans laquelle tous les membres du peuple de Dieu peuvent reconnaître les vertus, les charismes, la vocation, les ministères et le potentiel de chacun. Une culture où nous sommes tous convaincus que, à partir du rôle qui nous correspond, nous sommes tous coresponsables du présent et de l'avenir de l'Église et que ce n'est qu'en marchant main dans la main et en apportant chacun les charismes que l'Esprit Saint nous a donnés, que nous pourrons construire une Église plus fidèle à sa mission, plus crédible et plus proche de tous, en particulier des plus vulnérables.
À cette fin, quelques mesures viennent à l'esprit :
- Reprendre l'étude de certains points fondamentaux du "Preadicate Evangelium" et rendre plus accessibles et connus de tous, à travers les paroisses, les associations, les groupes, les universités, etc. les résultats du Document final du Synode sur la Synodalité, Magistère de l'Église, qui traite de ces thèmes. Ce document contient déjà des indications très concrètes qui constituent un guide pour la mission des Églises dans les différents continents et dans les différents contextes.
- Partager les bonnes pratiques et les réussites des femmes à différents niveaux de responsabilité dans l'Église, où, en travaillant main dans la main avec l'évêque, les prêtres et les autres fidèles, elles ont accompli de grandes choses pour le bien de l'Église.
- Travailler beaucoup dans les séminaires et avec les jeunes et les enfants, les jeunes hommes et les jeunes femmes, dans les écoles et les familles, continuer à changer petit à petit cette culture cléricaliste avec certains relents de machisme ....
- Promouvoir l'éducation au dialogue, à l'écoute et au discernement dans la prière (dans un style synodal) à chaque occasion et éviter autant que possible les confrontations violentes stériles, verbales, écrites ou de toute autre nature, qui ne servent qu'à éloigner les positions.
- L'Église devra définir rapidement et clairement les points de débat tels que le diaconat des femmes, l'écoute éventuelle de l'ensemble du peuple de Dieu dans la nomination des évêques et d'autres questions qui sont actuellement étudiées dans les dix groupes d'étude mis en place par le pape François.
- Nous devons travailler dur à la formation théologique et pastorale des femmes, en particulier des femmes laïques, afin que nous puissions assumer sans crainte les responsabilités qui sont les nôtres.
En termes de formation théologique et pastorale, comment évaluez-vous la situation actuelle des femmes dans le monde universitaire ecclésial ? Quels sont les défis auxquels elles sont confrontées pour accéder à des postes plus influents dans ce domaine ?
- Il reste encore beaucoup à faire dans la formation théologique et pastorale des femmes, en particulier des femmes laïques. Traditionnellement, les meilleures bourses et possibilités d'études ont été accordées aux prêtres et religieux masculins.
Je pense que les défis les plus importants sont les suivants :
- Que les bourses d'études et les places dans les universités et les écoles théologiques et pastorales soient accordées de manière égale aux hommes et aux femmes, en tenant compte avant tout de leurs capacités.
- Les évêques, les supérieurs et les dirigeants des diocèses, des paroisses, des organismes catholiques et des organisations à différents niveaux doivent être conscients du fait qu'investir du temps et des ressources financières dans les femmes, religieuses et laïques, est un excellent investissement, compte tenu du "grand rendement que de tels investissements peuvent avoir".
- Ouvrir aux femmes des domaines qui leur ont été fermés et pour lesquels elles ont une grande expérience et des dons, comme la présidence des tribunaux ecclésiastiques où sont entendues les affaires familiales.
- Que les hommes et les femmes, laïcs et religieux, soient formés ensemble afin qu'ils puissent partager leurs expériences et leurs besoins particuliers et être mieux préparés à servir l'ensemble du peuple de Dieu.
Le pape François a encouragé la synodalité, qui promeut la participation active de tous les membres de l'Église. Comment pensez-vous que cette culture pourrait transformer le rôle des femmes dans l'Église au niveau mondial et local ?
- Le document contient déjà des indications très concrètes qui constituent un guide pour la mission des Églises, dans les différents continents et dans les différents contextes. C'est maintenant à nous tous, évêques, prêtres, religieux, consacrés et laïcs, unis dans la diversité, de travailler pour faire vivre le synode, pour rendre le contenu du document final accessible à tous et pour changer la culture et la vie du Peuple de Dieu dans nos réalités respectives. Et dans tout cela, nous, les femmes, avons un rôle très important à jouer, à la fois dans nos propres organisations, paroisses et communautés, et aux niveaux diocésain, national et international.
L'objectif est clair : cheminer vers un renouveau spirituel et une réforme structurelle pour rendre l'Église plus participative et missionnaire ; une Église où tous, y compris bien sûr les femmes, à partir de notre propre vocation, charisme et ministère, nous nous écoutons les uns les autres et apprenons à discerner ensemble, guidés par la lumière de l'Esprit Saint, les meilleurs moyens d'apporter l'amour de Dieu aux autres ; une Église missionnaire qui sait aller à la rencontre des hommes et des femmes de notre temps, en particulier de ceux qui en ont le plus besoin, en tenant compte des circonstances de chaque lieu ; une Église dans laquelle les femmes et les laïcs, dûment formés, peuvent participer à la prise de décision et assumer le leadership et la coresponsabilité qui nous correspondent à différents niveaux.
Je conclurai en disant qu'à l'UMOA, nous sommes de grands promoteurs de la synodalité ; en fait, nous avons ouvert il y a plus d'un an une école de synodalité grâce à laquelle nous avons déjà formé plus de 250 facilitateurs, pour la plupart des femmes, venant de 49 pays, et nous avons eu des conversations sur l'esprit au niveau mondial auxquelles ont participé près de 700 femmes de 78 pays.
En cette année jubilaire, nous sommes déterminés à poursuivre le voyage synodal avec espoir et à continuer à former des missionnaires de la synodalité, afin que dans nos propres familles, organisations, communautés, paroisses et diocèses, l'Église puisse être transformée.