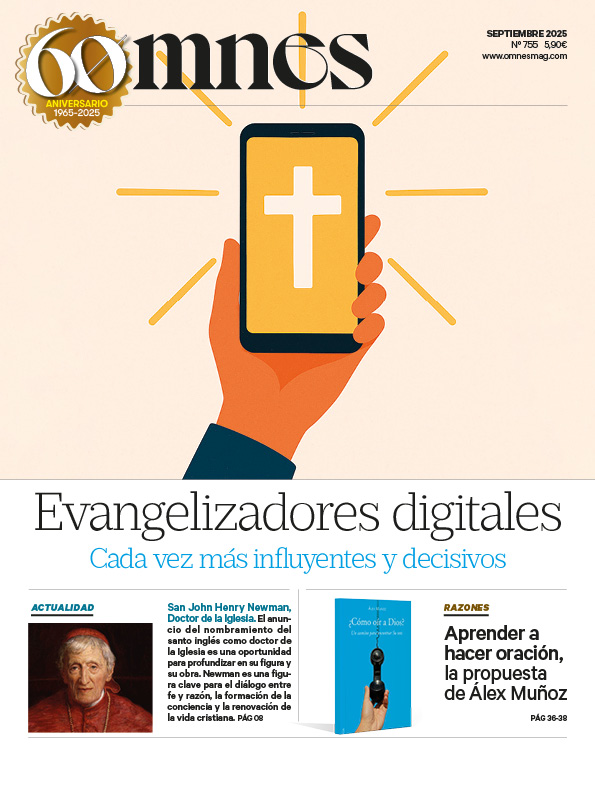Le mois d'avril dernier a marqué le vingtième anniversaire de la mort de Saint Jean-Paul II. Sa figure a profondément marqué l'histoire récente de l'Église et du monde. Poète et dramaturge, philosophe et théologien, il était un homme d'une culture extraordinaire, un leader moral acclamé et respecté, un pasteur proche de son peuple, un témoin vivant de la foi incarnée.
Martyr de son vivant, sa réputation de sainteté a explosé après sa mort dans un élan populaire sans précédent, appelant à son élévation immédiate sur les autels. Il a été béatifié six ans après sa mort et canonisé en l'espace d'une décennie. Son long pontificat a laissé un vaste corpus d'enseignements, qui ont été abondamment exposés et traités au cours des dernières décennies. Cependant, il reste encore des perspectives à explorer. Cet article propose l'une d'entre elles, en présentant ce saint pape comme un promoteur de la recherche de la vérité, de la bonté et de la beauté comme un moyen de rechristianiser la culture en l'inspirant d'un humanisme christocentrique.
Un orgue polyphonique pour une symphonie anthropologique
La figure intellectuelle et pastorale de Karol Wojtyła/Jean-Paul II n'a cessé de croître au fil des ans, comme en témoignent les nombreuses publications qui continuent de paraître après sa mort. Son principal engagement - d'abord en tant que prêtre et professeur d'université, puis en tant que pasteur de l'Église universelle - peut se résumer au dialogue mutuellement enrichissant entre la Révélation chrétienne et la modernité (ou plutôt la post-modernité), en particulier dans les domaines de l'anthropologie, de l'éthique et de la culture. Un tel défi coïncidera pleinement avec la préoccupation exprimée, dans le même sens, par le Concile Vatican II, comme on peut le voir dans les premiers numéros de la Constitution pastorale Gaudium et SpesLe jeune archevêque de Cracovie de l'époque a participé activement à sa rédaction.
Motivé par ce défi, Karol Wojtyła a entrepris de développer une anthropologie personnaliste et transcendante qui, basée sur un solide fondement aristotélico-thomiste et enrichie d'une approche phénoménologique, répondrait aux exigences de la modernité - subjectivité, liberté et autonomie, conscience - à partir d'une perspective chrétienne. Sur cette base, il développe une éthique de la personne et de la culture, qui reflète également sa théorie de l'action humaine (la personne se projette dans ses actions ; l'action humaine a un effet transformateur, c'est-à-dire humanisant).
Plus tard, au cours de son magistère pétrinien, il a poursuivi son engagement pour clarifier la réalité christocentrique de l'homme et du monde, proposant ainsi un humanisme nouveau et régénérateur, conformément aux directives du dernier concile œcuménique.
Les spécialistes de la vie et de l'œuvre de Wojtyła ont plutôt souligné l'unité et la cohérence profondes d'une pensée, présente dans une personnalité aussi puissante que multiple : poète, dramaturge, philosophe, théologien et pasteur. Comme l'écrivait Massimo Serreti dans les premières années de son pontificat, "cette multiformité de la pensée - tout à fait inhabituelle aujourd'hui dans notre paysage culturel - permet à Wojtyła d'aborder la vérité sur l'homme et la vérité sur Dieu à partir de plans et d'angles visuels disparates, mais étonnamment confluents en fin de compte".
Esta misma opinión otro experto en su figura, Lluís Clavell, para quien las obras de Wojtyła «proceden del interior del sujeto único e irrepetible, pero según varios registros, tales como el sonido de un órgano a lo largo de un concierto». Se trata de una metáfora muy acertada. El propio san Juan Pablo II la utilizará en una carta al profesor Giovanni Reale, responsable de la edición crítica de sus obras filosóficas en italiano. En ella defendía cómo la verdad sobre el ser humano y sobre el mundo puede explorarse tanto a través del arte (música, poesía, pintura) como de la reflexión filosófica o teológica, de modo que, entre todos estos modos de expresión podemos obtener «una suerte de singular ‘sinfonía’ antropológica, en la cual la vena inspiradora que fluye del perenne mensaje cristiano (…) orienta a todas las culturas para mayor gloria de Dios y del hombre, inseparablemente unido al misterio de Cristo».
Et il a ajouté : "Je remercie le Seigneur, qui m'a donné l'honneur et la joie de participer à cette entreprise culturelle et spirituelle : d'abord avec la passion de ma jeunesse, puis, au fil des années, avec une approche progressivement enrichie par le contraste avec d'autres cultures et, surtout, par l'exploration de l'immense patrimoine doctrinal de l'Église".
La voie des transcendantalistes
Cette proposition anthropologique et éthique que Karol Wojtyła/Jean-Paul II met en avant peut être analysée de différents points de vue. L'un d'entre eux consiste à l'éclairer à travers le prisme des transcendances de l'être - en particulier, du verumle site bonum et le pulchrum-. Certes, ce saint pape ne les a pas traités de manière monographique, mais il est frappant de constater qu'il s'y réfère constamment, notamment lorsqu'il évoque le fondement anthropologique et éthique de la personne, ainsi que sa projection dans la sphère culturelle et sociale.
Dans quelle mesure la recherche du bien, de la vérité et de la beauté est-elle essentielle dans les enseignements de ce penseur et pape ? Nous pouvons évoquer deux de ses déclarations, aussi révélatrices que méconnues. L'une d'entre elles a eu lieu lors d'une de ses visites pastorales dans une paroisse romaine (Santa Maria in Traspontina), où, après avoir été reçu par une chorale d'enfants, il a profité de l'occasion pour parler de l'importance de l'éducation à la beauté.
Dans le colloque improvisé qui a suivi, en réponse à une question, saint Jean-Paul II a révélé quelque chose qui était profondément gravé dans son cœur : "L'un d'entre vous m'a demandé ce que le pape aurait fait s'il n'avait pas été pape (...) Même si je n'étais pas pape, ma tâche principale serait de préserver, de protéger, de défendre, d'accroître et d'approfondir cette aspiration au bien, au vrai, au beau".
L'examen de ses interventions lors de rencontres avec des représentants de la culture, des artistes et des communicateurs montre qu'il ne s'agit pas d'une remarque isolée. Ainsi, à peine un mois et demi après avoir été élu successeur de Pierre, lors d'une audience avec des représentants de l'Università Cattolica del Sacro Cuore de Milan à l'occasion du centenaire de son fondateur, le père Agostino Gemelli, le nouveau pontife polonais a clairement affirmé que "la personne humaine ne trouve son plein épanouissement qu'en référence à Celui qui constitue la raison fondamentale de tous nos jugements sur l'être, le bien, la vérité et la beauté". Dès lors, les références explicites à ces trois transcendances seront nombreuses dans les discours et les allocutions adressés aux acteurs de la culture, de l'art et de la communication.
Le "stigmate éternel de Dieu" dans le monde et dans le cœur de l'homme
En effet, partant du mystère de l'homme en tant que personne, créée à l'image de Dieu, Karol Wojtyła/Jean-Paul II propose un itinéraire ascendant vers Dieu, car, dit-il, "ce qui est humain porte en soi le stigmate éternel de Dieu, c'est une image de Dieu". La Vérité, le Bien et la Beauté ne sont que d'autres noms de cet Être suprême et personnel que nous appelons Dieu, et c'est à eux que nous aspirons ; ils sont l'objet de nos pouvoirs spirituels (intelligence, volonté, affections). À partir de cette conviction, Wojtyła suivra un parcours intellectuel et artistique particulier, fondé sur la phénoménologie et éclairé par la foi, qu'il a eu l'occasion de décrire dans ses sermons à la Curie en 1976 et rassemblés dans le livre Signe de contradictionLes itinerarium mentis in Deum émerge des profondeurs des créatures et des profondeurs de l'homme.
Dans ce parcours, la mentalité moderne se fonde sur l'expérience de l'homme et sur l'affirmation de la transcendance de la personne humaine (...). La transcendance de la personne est étroitement liée à la référence à Celui qui est la base fondamentale de tous nos jugements sur l'être, sur le bien, sur la vérité et sur la beauté. Elle est liée à la référence à Celui qui est aussi totalement Autre, parce qu'il est infini".
La voie des transcendantaux répond ainsi au besoin anthropologique de l'être humain de s'ouvrir à l'infini, auquel il aspire par sa propre nature rationnelle et spirituelle. Ces catégories ou dimensions de l'être (vérité, bien, beauté) constituent les fils conducteurs de la trame qui unit l'homme (créature, être participant) à Dieu (créateur, être par essence), grâce à sa condition de imago Dei. Wojtyła lui-même a essayé de suivre cette triple voie à travers l'art, la philosophie et la théologie, convaincu qu'en fait, tout ce qui est vraiment humain reflète l'empreinte de Dieu. Ainsi, comme le note Wojtyła lui-même, "la itinerarium mentis in Deumen tant que "voie de la pensée de l'homme tout entier", finit par devenir une véritable "voie de l'homme tout entier", une véritable "voie de l'homme tout entier".itinerarium hominis".
Ce chemin de la vérité, de la bonté et de la beauté est particulièrement adapté à la récupération des fondements chrétiens d'une société et d'une culture qui se sont éloignées de Dieu et de l'homme lui-même, et qui sont en quelque sorte tombées dans l'autodestruction et le désespoir. Face à la crise de la métaphysique - et à la dispersion ou à la désunion des transcendantaux qui en découle - provoquée par la philosophie moderne, saint Jean-Paul II a retrouvé le fondement métaphysique de la philosophie et a proposé une perspective personnaliste et transcendante, d'où découle une proposition éthique également ancrée dans la personne humaine et dans sa transcendance. En ce sens, le Pape Wojtyła a voulu relever cet énorme défi culturel et anthropologique évoqué par le Concile Vatican II et a construit une solide réponse anthropologique et éthique aux questions posées par la pensée moderne.
Un projet de vie et d'enseignement
Karol Wojtyła/Jean Paul II a consacré sa vie à cette voie, avec constance, conviction et fermeté. D'abord signalée à l'époque où il était philosophe et professeur d'éthique d'un point de vue plus anthropologique, elle a acquis un plus grand développement et une plus grande maturité tout au long de son pontificat, au cours duquel il l'a également abordée d'un point de vue théologique (christologique et trinitaire). Plus précisément, il réitère avec insistance la nécessité de fonder les expressions culturelles, artistiques et communicatives sur les transcendances de l'être. La culture est l'incarnation des expériences spirituelles d'un peuple", dira-t-il à une occasion, "et concrétise la vérité, la bonté et la beauté". En effet, la recherche du vrai et du beau conduit l'homme à la rencontre avec Dieu et avec la réalité la plus profonde de son être.
Dans la mesure où la personne se projette dans son œuvre, elle peut contribuer à ce que cet itinéraire soit également suivi par ceux qui contemplent ce qui est sorti de ses mains ou qui est le fruit de son intelligence ou de son talent créatif. Les manifestations culturelles et artistiques, ainsi que les contenus diffusés par les médias et les divertissements, constituent donc un canal idéal pour "un rayonnement culturel plus vigoureux de l'Église dans ce monde à la recherche de la beauté et de la vérité, de l'unité et de l'amour". Cette recherche anthropologique devient également une rencontre christologique, puisque Jésus-Christ est le modèle selon lequel l'homme a été créé et, en tant que Voie, Vérité et Vie, il est également la pleine manifestation de la Beauté, de la Vérité et de la Bonté.
"Je porte ton nom en moi"
Tout au long de sa vie, ce saint pape a parcouru personnellement ces trois chemins de la beauté (en cultivant la poésie et le théâtre), de la raison (dans sa facette philosophique) et de la foi (en tant que théologien), résolu à trouver les traces divines présentes dans la personne humaine et dans la création (l'Église catholique, l'Église catholique et l'Église catholique). pulchrumle site verum et le bonum) pour élaborer, à partir de là, cette "symphonie" anthropologique qu'il a interprétée avec sa vie, dans le cadre de la mission évangélisatrice à laquelle Dieu l'a invité à participer. Ici aussi, il a honoré son rôle de pontifex ("constructeur de ponts"), car il a rapproché les deux rives parfois opposées de la foi et de la culture, et a également incarné l'idéal de l'humaniste chrétien, en encourageant la mise au service de l'Évangile de tous les moyens de communication, ainsi que des diverses expressions culturelles et artistiques.
Une grande partie de cet effort a consisté à redécouvrir le chemin des transcendants, ces traces ou stigmates de Dieu présents dans le cœur de l'homme. Il y fera encore référence dans le recueil de poèmes qu'il a écrit au crépuscule de sa vie (Triptyque romain), dans lequel il écrit : "Yo llevo tu nombre en mí, / este nombre es signo de la Alianza / que contrajo contigo el Verbo eterno antes de la creación del mundo (…) / ¿Quién es Él? El Indecible./ Ser por Él mismo. / Único. Creador del todo. / A la vez, la Comunión de las Personas. / En esta Comunión hay un mutuo regalo de la plenitud de la verdad, del bien y de la belleza"
Dans la lettre qu'il a adressée au professeur Giovanni Reale à la fin de sa vie, saint Jean-Paul II a exprimé sa gratitude à la Divine Providence pour l'avoir rendu capable de mener à bien une telle "entreprise culturelle et spirituelle" - un projet de vie entier - au centre duquel se trouve toujours "l'homme en tant que personne (...), image de l'Être subsistant, (...) objet d'une analyse philosophique et théologique incessante". A notre avis, on peut affirmer qu'il a plus qu'atteint cet objectif. Ce n'est pas en vain, comme l'affirme Rino Fisichella, que "chaque successeur de Pierre est appelé au bon moment et correspond, par sa personnalité, aux besoins qui surgissent sur la tapisserie de l'histoire".
Sacerdote. Doctor en Comunicación Audiovisual y en Teología Moral. Profesor del Instituto Core Curriculum de la Universidad de Navarra.