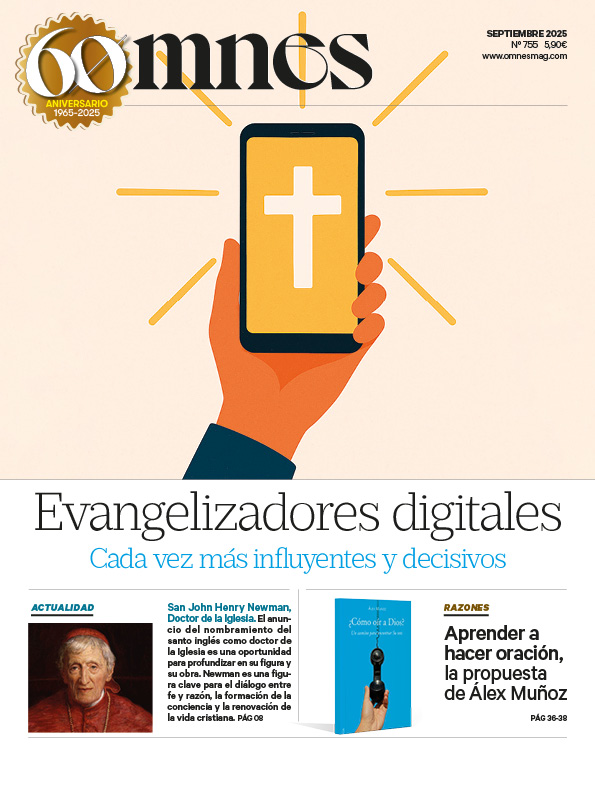La Conférence épiscopale espagnole (CEE) a manifesté son soutien à la position de la Commission islamique d'Espagne concernant la décision du conseil municipal de Jumilla de restreindre les manifestations religieuses dans les espaces publics.
Dans une déclaration, les évêques rappellent que "les manifestations religieuses publiques, entendues comme la liberté de culte, sont protégées par le droit à la liberté religieuse", consacré par l'article 16.1 de la Constitution espagnole et l'article 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme.
Selon la CEE, la seule intervention légitime des autorités dans ce domaine devrait être "uniquement en cas de trouble de l'ordre public", toujours évaluée "objectivement par des spécialistes et selon des critères techniques", en évitant les décisions "arbitraires ou idéologiques". Ils soulignent que, si des restrictions sont appliquées pour protéger le bien commun, elles devraient être étendues à tout type de manifestation dans les espaces publics, et pas seulement à celles de nature religieuse.
La note avertit que la limitation de ces droits pour des motifs religieux "est une discrimination qui ne peut avoir lieu dans les sociétés démocratiques" et qu'"elle ne concerne pas seulement un groupe religieux, mais toutes les confessions religieuses ainsi que les non-croyants".
Que s'est-il passé à Jumilla ?
Le conseil municipal de Jumilla a suscité une vive controverse en approuvant, le jeudi 7 août dernier, une motion - soutenue par le PP et Vox - qui limite l'utilisation des installations sportives municipales exclusivement aux activités sportives organisées par le conseil municipal, en interdisant expressément les événements religieux tels que la fin du ramadan et la fête de l'agneau.
Cette mesure a été considérée par la communauté musulmane locale comme un manque de respect et un coup porté à la coexistence. Mohamed Ajana, secrétaire de la Commission islamique d'Espagne, a exprimé sa "préoccupation" face à une décision qui entrave la liberté religieuse.
Confusions possibles
La controverse entourant la décision du conseil municipal de Jumilla de limiter l'utilisation des centres sportifs municipaux aux activités sportives organisées par le conseil - une mesure qui empêche les célébrations religieuses telles que la fin du ramadan ou la fête de l'agneau - a suscité des critiques de la part de Vox (promoteur de la motion) et du PP (qui s'est abstenu de la faire adopter), ainsi que de la Conférence épiscopale espagnole (CEE), qui s'est alignée sur la Commission islamique pour défendre la liberté de culte.
Selon les juristes consultés, la proposition initiale de Vox implique une confusion entre les "manifestations religieuses publiques" et l'utilisation occasionnelle d'un espace public géré par l'administration. Si les premières sont protégées par l'article 16.1 de la Constitution et l'article 21 (réunion et manifestation), à condition d'être communiquées à l'avance et de ne pas troubler l'ordre public, l'utilisation d'un centre sportif est régie par le droit administratif et les compétences municipales (loi 7/1985 sur les bases du régime local), qui permettent au conseil municipal d'établir des critères d'utilisation.
La municipalité peut limiter l'utilisation des installations aux activités sportives, mais elle doit le faire de manière neutre et générale, sans interdire uniquement les activités religieuses, car cela ouvrirait la porte à une éventuelle discrimination. Les experts en droit constitutionnel consultés par Omnes expliquent qu'une municipalité peut limiter l'utilisation d'un centre sportif exclusivement aux activités sportives ou interdire certains événements pour des raisons objectives telles que la santé publique ou le risque pour les installations. Ce qu'elle ne peut pas faire, c'est opposer son veto à une activité pour des raisons religieuses ou discriminer entre les confessions : si une messe catholique est autorisée, une prière islamique doit l'être aussi, et vice-versa. Ce principe de neutralité et de non-discrimination est protégé par l'article 14 de la Constitution et la loi organique sur la liberté religieuse.
Les objections adressées à la CEE soulignent que sa déclaration repose sur un postulat erroné : elle n'a pas interdit une procession ou une manifestation sur la voie publique, mais une activité religieuse à l'intérieur d'un bâtiment municipal, dont l'utilisation est laissée à l'appréciation de l'autorité locale. De même, le Conseil pourrait refuser une messe dans ces locaux pour les mêmes raisons. En ce sens, la liberté religieuse (art. 16 CE) n'implique pas un droit automatique d'utiliser tout espace public pour des actes de culte, mais plutôt l'interdiction de la discrimination et l'obligation de justifier les limitations par des critères objectifs et non idéologiques.
La controverse met ainsi en évidence la frontière ténue entre la garantie des droits fondamentaux et l'exercice des pouvoirs de gestion des biens publics, soulignant la nécessité d'une précision juridique dans un débat aux implications sociales et politiques évidentes.