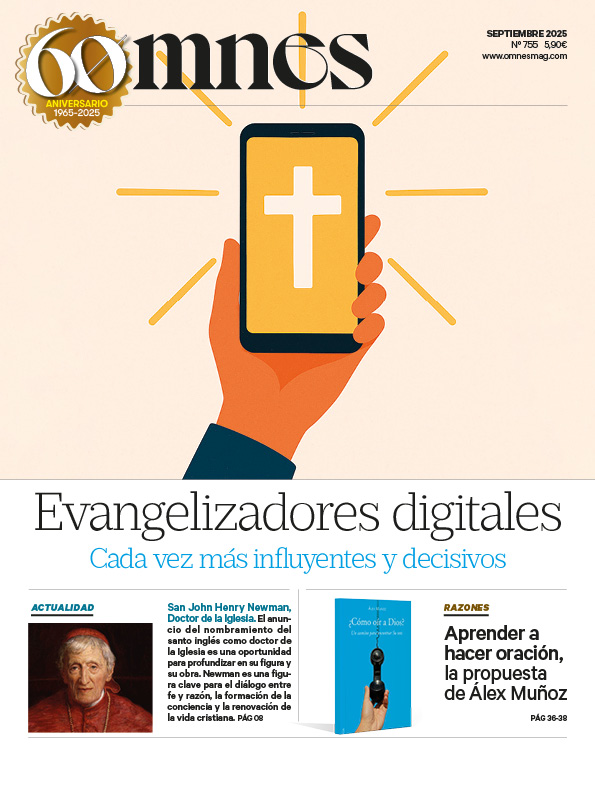Les 23 et 24 juillet, une conférence spécialisée dans la liberté religieuse et la polarisation, avec un accent particulier sur les questions juridiques, s'est tenue à l'Université d'Oxford. L'un des intervenants était le professeur Rafael Palomino, professeur de droit à l'université Complutense de Madrid. Nous nous sommes entretenus avec lui sur certaines des questions soulevées lors de la conférence.
Votre intervention porte sur la judiciarisation des conflits liés à la liberté religieuse et à la polarisation en Europe. Quelles sont les principales causes que vous identifiez pour expliquer le transfert croissant de ces débats vers la sphère judiciaire ?
- Il y a de moins en moins d'instances non étatiques partagées par tous qui ont une autorité reconnue pour résoudre les conflits sociaux. Cela signifie que nous transférons tous nos conflits (des conflits familiaux aux grandes questions morales) aux tribunaux.
De plus, les revendications sociales et les aspirations personnelles de toutes sortes sont transformées ou traduites en droits fondamentaux ; et comme la protection de ces soi-disant droits est du ressort des tribunaux, on assiste là aussi à une judiciarisation des conflits.
Cela met-il la démocratie en danger ?
- C'est le cas. Le risque est, entre autres, que la judiciarisation conduise inévitablement à un récit de gagnants et de perdants : il n'y a pas de négociation, pas de dialogue, certains gagnent et d'autres perdent, certains sont accueillis à bras ouverts par l'État, d'autres sont répudiés. La société civile est divisée et la démocratie est instrumentalisée.
La polarisation religieuse est souvent liée à la sécularisation. Existe-t-il un consensus parmi les experts sur la question de savoir si la sécularisation est remplacée par un nouveau type de religiosité publique ou identitaire ?
- Il n'y a pas d'accord sur ce point. Certains experts affirment que l'instrumentalisation de la religion par les partis populistes pourrait même accélérer la sécularisation. Mais les processus nationaux sont très différents les uns des autres. En Italie, par exemple, la religion catholique a joué un rôle important dans la construction d'une religion civile cohésive, indépendamment de ce que les populismes ont ou n'ont pas prôné.
En France, le populisme a été dirigé contre l'islam, mais pas en faveur du christianisme, mais pour défendre la laïcité républicaine. Aux Pays-Bas, il n'y a pas de prise en charge de l'identité religieuse par les acteurs politiques. La Pologne et la Hongrie sont peut-être les pays qui ont intégré l'identité religieuse dans l'action politique.
Des exemples ont-ils été discutés sur la manière dont les gouvernements européens ont géré de manière équilibrée (ou non) la relation entre la liberté religieuse et la santé publique, par exemple pendant la pandémie ?
- Cette question reste un sujet d'intérêt pour les experts, même si plusieurs années se sont écoulées. Deux éléments ont été particulièrement critiqués en ce qui concerne la situation de la liberté religieuse pendant la pandémie. Premièrement, le manque de sensibilité juridique pour limiter proportionnellement les droits fondamentaux, en particulier la liberté religieuse, dans les situations où la santé publique est en jeu.
Deuxièmement, la discrimination de la religion par rapport à d'autres activités sociales considérées comme "essentielles" : il existe une sorte de parti pris ou de préjugé somatique selon lequel l'État considère les supermarchés, les cafés, les coiffeurs ou les studios de tatouage comme des activités essentielles, alors que les activités dans les lieux de culte ne le sont pas : après tout, affirme-t-on, on peut prier n'importe où.....
En ce qui concerne les Etats-Unis, quelles différences structurelles ont été mises en évidence entre les modèles américain et européen en ce qui concerne le rôle de la religion dans l'espace public et la gestion des conflits idéologiques ?
- En général, il semble qu'aux États-Unis, par rapport à l'Europe, la polarisation sociale soit devenue beaucoup plus aiguë, surtout depuis les présidences Obama, de sorte que les deux grands partis, républicain et démocrate, absorbent complètement toutes les autres identités et positions sur toutes les questions possibles : l'immigration, la pratique de la religion, l'idéologie du genre, la politique d'identité, les soins de santé, etc. Cela semble rendre la compréhension et le dialogue difficiles, tant au niveau social qu'institutionnel. En Europe, cependant, une telle situation ne s'est pas produite.
Avez-vous une évaluation du rapport ?La prochaine vague: La prochaine vague : comment l'extrémisme religieux reprend le pouvoir".par le Forum parlementaire européen pour les droits sexuels et reproductifs
- Lors de certaines séances du séminaire, ce rapport a été commenté, car il correspondait au contenu des sujets abordés. Outre le contenu spécifique du rapport, je pense qu'il n'y a rien d'inhabituel dans le fait que différents groupes, fondations ou pays (également des laïcs, des séculiers, des défenseurs des droits génésiques, etc. qui ne sont pas le sujet du rapport) soutiennent ou financent des activités dans d'autres pays ou sur d'autres continents pour faire avancer leur cause. Le présent rapport est probablement le résultat d'un tel financement ou d'une telle promotion.