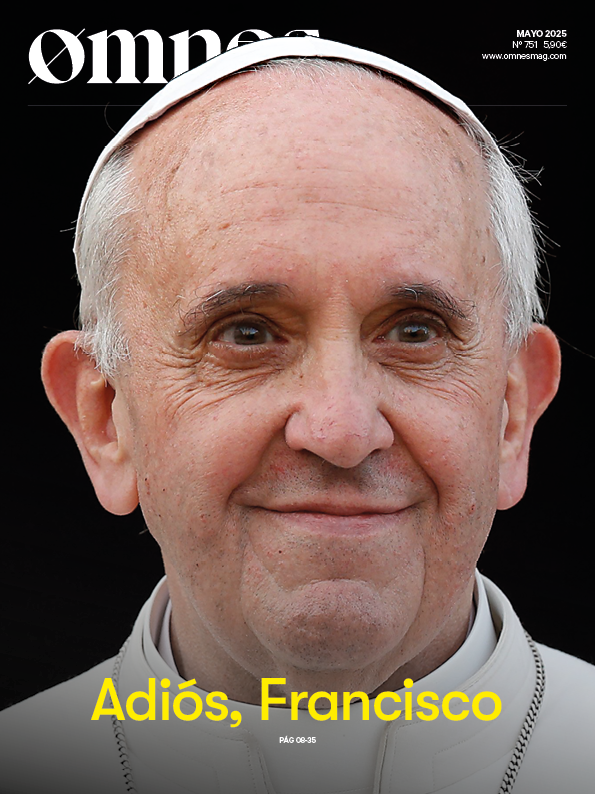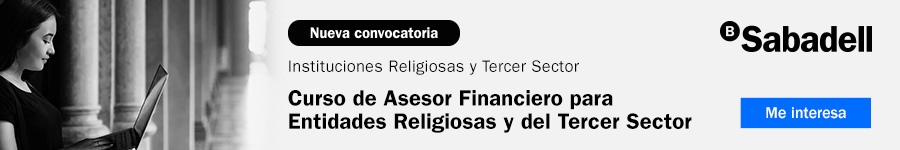À partir de la fin du XIXe siècle, suite à la pénétration du libéralisme en Espagne, un énorme fossé s'est creusé entre les classes dirigeantes du pays et les gens simples. Si, parmi les premières, il y avait des cas d'agnosticisme ou simplement des vies incrédules, parmi les secondes, il y avait une foi religieuse presque généralisée. D'autre part, il existait également une distinction entre la pratique chrétienne dans la vie des banlieues des grandes villes et la vie des villages.
La déchristianisation des masses laborieuses
La fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle ont été marqués par la déchristianisation des masses laborieuses en Espagne, notamment avec la naissance de quartiers extrêmes et de la pauvreté dans les zones rurales défavorisées du pays. Bien que de nombreuses initiatives à caractère social aient été lancées, surtout depuis l'encyclique de Léon XIII, Rerum NovarumLa déconnexion de grandes masses de travailleurs du message chrétien est un fait avéré.
Le niveau élevé d'analphabétisme en Espagne à cette époque est un facteur clé pour comprendre la haine qui s'est déchaînée pendant la période constitutionnelle de la Seconde République espagnole. On a parlé de la 40% à la fin de la dictature de Primo de Rivera. Seule l'ignorance expliquerait comment des œuvres d'art inestimables ont pu être détruites, des temples brûlés sans la moindre considération. Et elle expliquerait aussi comment les gens du village ont pu croire à des affirmations aussi farfelues que celles selon lesquelles les prêtres empoisonnaient les fontaines ou tuaient les enfants avec des bonbons empoisonnés.
La montée de l'anticléricalisme
En revanche, dès le début du XXe siècle, des secteurs consolidés d'intellectuels espagnols formés à l'incroyance, convaincus de leur athéisme et de leur agnosticisme, ont habilement touché les masses, principalement par le biais de la presse. L'action constante du krausisme et de l'Institución Libre de Enseñanza a sans doute eu une influence.
Une partie de la presse républicaine s'obstinait, dans ces années-là, à voir dans l'Église un pouvoir spirituel qui tyrannisait les consciences, et il était donc urgent de s'en débarrasser. A cela s'ajoutent les maisons d'édition qui se créent et les éditions populaires qu'elles publient, ainsi que des pièces de théâtre, etc.
L'influence de certains penseurs ne cessera de croître et leur aversion pour l'Église ira de la froideur à l'hostilité. Son reflet le plus clair est l'anticléricalisme croissant, et cet anticléricalisme est devenu une passion dans les masses ouvrières et dans certaines régions rurales. De toute évidence, ils se sont trompés : l'Église n'était pas la même que sous l'Ancien Régime et la foi catholique n'était pas aussi profondément enracinée qu'ils le pensaient. Comme le souligne Álvarez Tardío : "Il faut donc rejeter l'explication courante et élémentaire selon laquelle le laïcisme agressif des républicains était une réponse à l'antirépublicanisme intolérable des catholiques".
Le but de l'anticléricalisme n'est pas de contester la doctrine de l'Église, le contenu de l'Évangile ou la vérité de la foi proposée par l'Église, mais d'essayer de secouer le joug de la conscience et les formes sociales façonnées par l'Église. Ces nouveaux penseurs voulaient une morale laïque et des principes libéraux autonomes.. Il est intéressant de noter le phénomène qui s'est produit au cours du XIXe siècle en Espagne : d'une part, l'apparition d'intellectuels et, d'autre part, le fait de les voir exercer un magistère moral qui, jusqu'alors, ne correspondait qu'à l'Église. En raison du fort taux d'analphabétisme, ils ne manquent pas de s'adresser aux minorités. Quant au clergé, par la catéchèse, l'enseignement et les célébrations liturgiques, il s'adresse à la majorité des Espagnols tout au long de leur vie.
L'article 26 et le déclenchement de la "question religieuse".
Les discussions autour de l'article 26 de la Constitution en octobre 1931 ont fait émerger une multitude d'opinions contre l'action de l'Église, fortement chargées de passion. Comme le souligne Jackson : "Dès que les vannes ont été ouvertes, personne n'a pu réfléchir calmement à la nécessité d'une nouvelle réflexion entre l'Église et l'État". C'est donc comme un fleuve débordant de passions, y compris le nom lui-même : la "question religieuse", qui jusque là, pour la majorité du pays, était une question attachante, est apparue comme un problème, et apparemment un problème majeur, car on a consacré plus d'efforts à ces débats qu'aux graves problèmes économiques, structurels et éducatifs.
Néanmoins, l'influence de l'Église catholique est très forte dans tout le pays. Tant par le contrôle qu'elle exerce sur la plupart des établissements d'enseignement que par ses enseignants, qui sont pour la plupart de bons catholiques.
Une grande partie des intellectuels, ainsi que les classes dirigeantes, sont des catholiques bien éduqués, même si leur pratique spirituelle est plus ou moins fervente. Bien entendu, les coutumes sociales étaient fondamentalement chrétiennes. Les bonnes manières sont respectées. Il y avait sans doute un manque d'intellectuels catholiques ayant la formation adéquate pour présenter le message chrétien de manière passionnante, avec plus de force et de cohérence personnelle.
Il est intéressant de noter la bonne situation générale du clergé sous la Seconde République. C'est le résultat des séminaires et des diplômes qui y sont obtenus, ou à Rome à l'Université Grégorienne. Le clergé et les évêques jouissaient d'une bonne santé spirituelle : il y avait une abondance de prêtres pieux, vertueux, dévoués et exemplaires. En effet, le nombre de martyrs et de confesseurs pendant la guerre civile était frappant.
Le mythe d'une Église rétrograde
Intellectuellement, ils vivaient enfermés dans un petit monde intellectuel, mais ni les évêques ni le clergé n'avaient été touchés par la crise moderniste qui avait secoué l'Europe quelques années auparavant. D'autre part, il convient de rappeler la situation des facultés de théologie espagnoles qui, depuis 1851, date à laquelle elles ont cessé d'appartenir à l'Université civile, avaient perdu de leur prestige et de leur niveau scientifique. En 1932, Pie XI publia l'"Annuaire des facultés de théologie".Deus scientiarum Dominus"C'était la première fois qu'une faculté de théologie espagnole était créée. En fait, en 1933, la plupart des facultés espagnoles ont été fermées et il ne restait plus que celle de Comillas. En 1933, une visite canonique de tous les séminaires d'Espagne a eu lieu. Le clergé est abondant, mais mal réparti.
On ne peut pas non plus oublier que la philosophie dominante de nombreux étudiants universitaires était celle de la foi dans le progrès scientifique, et donc dans une nouvelle ère de progrès sans Dieu, ou du moins où Dieu était entre parenthèses. Ortega y Gasset est apparu comme un modèle proche pour beaucoup d'hommes formés autour des idées de l'Institut Libre d'Enseignement. Dans le feu de ces idées, la fausse appréciation de l'Église comme ennemie du progrès humain s'était consolidée.
D'autre part, dans de nombreux villages, une foi consolidée au fil des siècles a été préservée, où la vie tournait autour de la pratique sacramentelle et des saisons liturgiques, remplissant les coutumes, le folklore et les habitudes de vie. Il y avait des agnostiques et des incroyants, mais la majorité était chrétienne dans l'âme.
Les catholiques dans la République : entre engagement et déception
L'avènement de la République, le 14 avril 1931, et les élections rapides aux tribunaux constituants ont donné des résultats qui laissaient présager le pire pour les relations entre l'Église et l'État, car la majorité des députés élus appartenaient à la gauche et aux radicaux, qui avaient survécu à la dictature de Primo de Rivera.
En effet, le 6 mai, la Gaceta de Madrid publie une circulaire déclarant volontaire l'enseignement de la religion dans l'enseignement primaire. C'est la conséquence de l'abolition, quelques jours plus tôt, de la confessionnalité de l'État. En effet, en mai 1931, des églises et des œuvres d'art, comme l'Inmaculada de Salcillo à Murcie, sont brûlées.
C'est pourquoi, lorsque la majorité des députés de la Chambre a procédé à la discussion des articles de la Constitution, elle a mené un combat frontal contre l'Eglise. La plupart de ces députés n'avaient pas le niveau intellectuel et la formation religieuse nécessaires, à l'exception de quelques intellectuels au prestige reconnu. Mais les débats n'ont finalement servi qu'à mettre en évidence la loi de l'arithmétique contre la raison.
Tout semble indiquer que la gauche républicaine a présenté la question religieuse indépendamment de la situation réelle du pays et de l'opinion des catholiques sur la République ; ce qui les gênait, c'était la présence du catholicisme dans la vie sociale et culturelle.
Un examen des actions des protagonistes : dignitaires de l'Église, membres du gouvernement, députés, presse de l'époque, etc., montre clairement que ces Cortes ne représentaient pas la réalité du pays, mais qu'elles montraient dans toute leur crudité les différentes positions contre l'Église qui existaient à l'époque en Espagne. Le résultat, comme on le sait, fut une Magna Carta qui ne pouvait pas être un instrument de concorde et de pacification, puisqu'elle était née contre la volonté de la majorité des citoyens.
Une fois de plus, à propos du 19ème siècle, une petite minorité a tenté de corriger le cours d'un pays en prétendant, par le biais de Constitutions, provoquer une évolution. "Un pays peut être décatolisé, mais pas en vertu d'une loi". Au fond, une véritable culture démocratique faisait défaut.
Certains députés républicains étaient catholiques et avaient joué un rôle fondamental dans la naissance de la République, comme Niceto Alcalá Zamora qui, dans son célèbre discours contre les dispositions anti-ecclésiastiques de l'article 26 de la Constitution, le 10 octobre 1931, qui lui valut de démissionner de la présidence du gouvernement, déclara : "Je n'ai pas de conflit de conscience. Mon âme est à la fois fille de la religion et de la révolution, et sa paix consiste en ce que, lorsque les deux courants se mêlent, je les trouve d'accord dans l'expression d'une même source, d'un même critère, que la raison élève aux principes ultimes et que la foi incarne dans l'enseignement de l'Évangile. Mais moi, qui n'ai pas de problème de conscience, j'ai une conscience (...) Et quel remède me reste-t-il ? La guerre civile, jamais (...). Pour le bien de la patrie, pour le bien de la République, je vous demande la formule de la paix". Il incarnera ce qu'il appelle la troisième Espagne. Un gouvernement du centre, véritablement démocratique et non confessionnel. Il espère que la République aura contenu la révolution sociale et anticléricale.
Il convient de rappeler le célèbre discours contemporain de Manuel Azaña du 13 octobre 1931 : "J'ai les mêmes raisons de dire que l'Espagne a cessé d'être catholique que j'ai de dire le contraire de la vieille Espagne. L'Espagne était catholique au XVIe siècle, bien qu'il y ait eu de nombreux dissidents très importants, dont certains sont la gloire et la splendeur de la littérature castillane, et l'Espagne a cessé d'être catholique, bien qu'il y ait maintenant plusieurs millions d'Espagnols catholiques et croyants". La traduction est claire : l'Etat n'est plus catholique. Une fois la prémisse acceptée, ce qui serait valable : si le peuple espagnol dans son ensemble décide démocratiquement que l'État doit être non-confessionnel. Mais ce qui n'aurait pas de sens, c'est qu'il devienne anti-catholique, et qu'ensuite l'État persécute l'Église, la prive de sa liberté, et tente de la soumettre à lui-même.
Ce n'était pas la première fois qu'un petit groupe, au nom de la démocratie, tentait de subjuguer la conscience de la majorité. Mais l'accélération de l'histoire fait beaucoup de dégâts.
En effet, la plupart des lois promulguées étaient une conséquence du principe de sécularisation de l'État, mais beaucoup d'autres étaient une atteinte à la liberté proclamée pour tous dans la Constitution. Ce manque de vérité montrerait clairement que ce n'est pas le bien commun qui est recherché, mais plutôt des intérêts partisans, et finit par rompre l'harmonie et la coexistence pacifique. Bien sûr, "on n'a pas atteint une culture démocratique, mais une culture alternative".
L'éducation, épicentre de la confrontation
L'intention de la majorité parlementaire des Cortès constituantes était de retirer l'Église de l'éducation, comme le montre l'article 16 de la Constitution, mais dans la pratique, il était impossible de construire autant d'écoles et de former autant d'enseignants que nécessaire.
Enfin, il convient de rappeler les propos d'un autre Premier ministre de la République, Lerroux, qui notait : "L'Eglise n'avait pas accueilli la République avec hostilité. Son influence dans un pays traditionnellement catholique était évidente. La provoquer à la lutte, dès la naissance du nouveau régime, était impolitique et injuste, donc imprudent.
La réaction de l'épiscopat espagnol
Il est important de souligner que l'attitude du Saint-Siège à l'égard de l'avènement de la IIe République, le 14 avril 1931, a été cordiale. En témoignent les nombreuses démarches effectuées par le nonce et les prélats espagnols.
D'autre part, l'archevêque de Tolède, le cardinal Segura, devient un personnage gênant en raison de son approche traditionaliste selon laquelle l'Église doit guider le travail de l'État, et il ne cache pas son soutien à la monarchie. La République réussit à l'expulser d'Espagne et le Saint-Siège, dans un geste d'amitié envers la République, le destitua du siège de Tolède le 1.X.1931 et le remplaça par le cardinal Gomá. Cependant, il ne faut pas oublier que le gouvernement de la République, le 18.V.1931, a encouragé l'expulsion de l'évêque de Vitoria, Múgica, en soulevant le problème du carlisme en tant que force antirépublicaine et de son influence sur le peuple basque-navarrais.
Ainsi, avec l'adoption de la Constitution dans un court laps de temps, dans les premiers temps, la réaction de la société civile a été très positive. Vatican et des évêques espagnols était une attente sereine. La déclaration commune de l'épiscopat espagnol du 20 décembre 1931, en réponse à la Constitution approuvée le 12 décembre, rappelle que les droits et la liberté approuvés dans la Constitution s'appliquent à tous.
Niceto Alcalá Zamora lui-même démissionna de la présidence du gouvernement pour ne pas approuver ces articles anticatholiques, mais il présenta sa candidature à la présidence de la République pour que ces articles soient - à terme - adaptés à la situation objective du pays. Il y restera jusqu'en avril 1939.